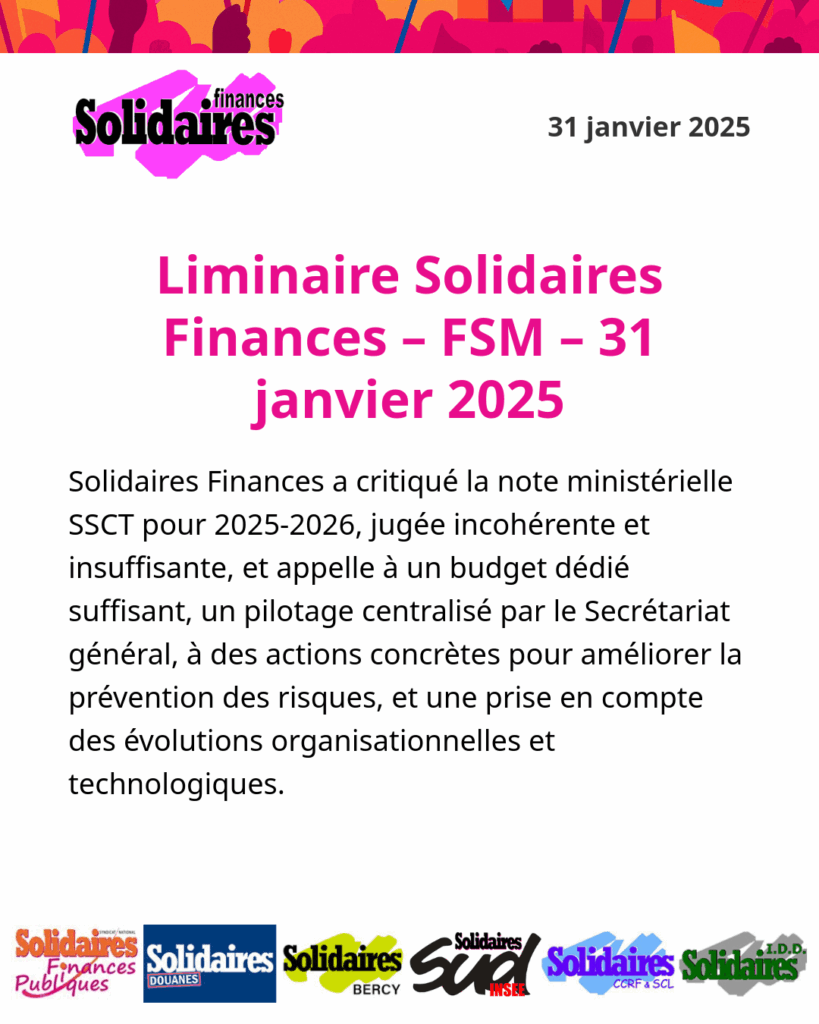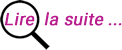Monsieur le Président, cher.es collègues,
A l’heure où la représentation nationale est encore en plein débat budgétaire, nous commencerons ces propos introductifs, par un rappel clair et ferme concernant le budget spécifique dédié aux conditions de travail, partie intégrante des moyens alloués aux politiques ministérielles. La volonté politique d’amélioration des conditions de travail est incarnée dans les décisions et orientations. Mais elle l’est également dans ce budget particulier. Pour cette raison, son évolution en chiffres est forcément un signifiant fort. S’il est maintenu – voire renforcé… (il n’est pas défendu de nourrir l’espérance en ce début d’année …) – , ce serait un signal positif. En cas de coup de rabot, par contre, ce dernier serait exactement et dramatiquement inverse ! Dans l’hypothèse d’une affirmation politique démenti par une dotation en berne, ledit engagement politique serait, sans jeu de mot un peu facile, largement démonétisé. Par ailleurs, nous rappelons que la première tentative de PLF 2025 qui répondait au même contexte budgétaire avait eu le bon de goût de préserver cette enveloppe dédiée. Dès lors, une réduction dans ce « second essai » serait aussi malvenue qu’incompréhensible.
Solidaires Finances souligne l’importance stratégique de la note ministérielle d’orientations en santé, sécurité et conditions de travail pour la période 2025-2026. Ce document n’est pas qu’une simple feuille de route : il est le pivot de la politique ministérielle en SSCT. En cela, il doit porter une ambition d’ampleur et structurer une déclinaison concrète permettant de faire vivre et de mettre en œuvre cette politique sur le terrain. Malheureusement, le projet soumis aujourd’hui est loin d’être à la hauteur de ces enjeux.
La note d’orientations devrait incarner une politique d’ensemble ambitieuse et convergente. Or, ce projet reste fragmenté et peine à offrir une vision globale et cohérente. Avec la mise en place des nouvelles instances CSA et FS, le niveau directionnel ajoute un niveau de déclinaison via les formations spécialisées de réseau (FSR). Dans ce contexte, il est indispensable que la note ministérielle s’impose comme référence unique pour garantir la cohérence des politiques SSCT. Si chaque direction venait à élaborer sa propre note d’orientations, l’efficacité globale de la politique SSCT serait gravement compromise. La perte de maîtrise des orientations par le secrétariat général, pilote historique de cette politique, poserait un problème majeur. Si cette prérogative venait à être perdue, le « doux chant des sirènes » de la DGAFP pourrait s’imposer, en vantant les avantages d’une interministérialisation de cette politique. Cependant, cette approche, prétendant mutualiser des ressources, entraînerait la captation du réseau ministériel spécifique et du budget propre associé. Une telle évolution affaiblirait non seulement la prévention, mais aussi les politiques d’amélioration des conditions de travail des agents et agentes des finances, menaçant ainsi les avancées construites au fil des années. Le manque de centralisation dans cette politique menace également l’harmonisation entre les différents services. Chaque direction risque d’adopter des approches hétérogènes, créant ainsi des inégalités de traitement entre les agents. Le SG doit réaffirmer son rôle de pilote unique pour assurer une stratégie claire et cohérente.
La politique SSCT doit être portée par un projet d’envergure, capable de rassembler et de mobiliser les acteurs ministériels (médecins du travail, ISST, APMP, ergonomes) mais aussi et surtout les directions de notre ministère. Ce projet doit donner des orientations claires et des outils concrets pour agir au niveau local. Or, cette note reste trop générale, voire vague. Les actions proposées manquent de substance et d’éléments opérationnels. Prenons l’exemple de la prévention de la désinsertion professionnelle : quelles consignes sont données aux directions ? Quels objectifs précis doivent être atteints ? Le même constat s’applique au DUERP, un outil pourtant central, dont la mise en œuvre repose sur des acteurs de prévention insuffisamment accompagnés. En l’absence de directives claires et de moyens adéquats, comment espérer une mobilisation efficace sur ces sujets ? La note manque aussi de priorités stratégiques clairement définies. Chaque axe devrait être accompagné d’une feuille de route précise, d’objectifs mesurables et d’un calendrier rigoureux. Cela inclut également un suivi régulier et une évaluation transparente des résultats obtenus. Sans cette discipline, le risque est grand que la note demeure une simple déclaration d’intentions. Enfin, le projet peine à considérer les spécificités des collectifs de travail. Chaque direction doit avoir les moyens d’adapter les orientations aux réalités de ses agents, tout en respectant un cadre ministériel fort. La prévention des risques doit être pensée à la fois globalement et localement pour être pleinement efficace.
La santé au travail ne peut se résumer à des outils ou à des procédures. Elle repose avant tout sur la manière dont le travail est organisé et sur la capacité des agents et des agentes à réaliser leurs missions dans des conditions qui favorisent leur autonomie et leur maîtrise des moyens mis à disposition, tout en assurant des effectifs suffisants pour garantir une charge de travail soutenable. Cette dimension, pourtant essentielle, est totalement absente de la note. Aucune réflexion approfondie n’est menée sur l’organisation du travail, qui constitue pourtant un levier fondamental pour prévenir les risques psychosociaux et garantir la santé au travail. Par exemple, le télétravail, qui bouleverse les collectifs de travail et les modes d’organisation, est à peine évoqué. Quels sont les impacts concrets de ces transformations sur les collectifs, l’encadrement et les conditions de travail ? Ces questions méritent d’être traitées de manière plus systématique. Le travail, dans sa dimension subjective et collective, doit être replacé au centre des politiques SSCT. Cela suppose d’interroger les conditions dans lesquelles les agents exercent leur activité, les marges de manœuvre dont ils disposent, ainsi que les tensions liées à la charge de travail et aux objectifs. Ces enjeux, bien que complexes, sont essentiels pour construire une prévention véritablement efficace. Par ailleurs, il est primordial de réintroduire des espaces de discussion sur le travail dans les collectifs. Ces espaces permettent non seulement d’identifier les difficultés rencontrées par les agents, mais aussi de définir des modalités de travail plus conforme aux exigences de leurs missions. Ce sont des outils indispensables pour redonner du sens au travail et renforcer les collectifs, qui sont souvent mis à mal par les transformations organisationnelles. Cependant, nous peinons à croire que l’impulsion du guide ANACT « Agir sur les transformations du travail » puisse réellement soutenir cet effort. En effet, le faible suivi et l’absence d’animation par le SG autour du guide sur le télétravail de l’ANACT nourrissent nos doutes. Quant à ce nouveau guide, déjà publié depuis plusieurs mois, aucun retour tangible n’a été constaté à ce jour.
Pour que cette note d’orientations devienne le document d’envergure qu’elle doit être, Solidaires Finances formule les demandes suivantes :
- Garantir un budget suffisant et transparent dédié à la SSCT : Le maintien, voire le renforcement, du budget dédié aux conditions de travail est indispensable pour concrétiser les ambitions affichées. Ce budget doit être accompagné d’un suivi rigoureux, d’un calendrier d’investissements détaillé, et d’une implication renforcée des instances de dialogue social dans son évaluation.
- Renforcer le pilotage ministériel : Le SG doit conserver son rôle central et garantir que les directions appliquent la note ministérielle en l’état, sans décliner des notes directionnelles qui viendraient créer de la confusion.
- Replacer le travail au cœur de la politique SSCT : La santé au travail passe par une prise en compte systématique de l’organisation du travail et de son impact sur les collectifs. Cela implique une réflexion approfondie sur les conditions de travail, le sens donné à l’activité et les évolutions organisationnelles.
- Proposer des actions concrètes : Chaque axe stratégique doit être accompagné de consignes précises, d’objectifs quantifiables et d’un calendrier clair. Les directions doivent être impliquées dans une logique de responsabilisation et d’évaluation continue.
- Mobiliser et former les acteurs de prévention : Les AP, ISST, médecins du travail et les APMP doivent bénéficier de moyens renforcés et d’une formation adaptée. La professionnalisation en particulier des AP et APMP est un préalable à toute politique SSCT ambitieuse.
- Anticiper les enjeux futurs : L’impact des technologies, le télétravail et les transformations organisationnelles doivent être intégrés dans une stratégie d’ensemble. Ces évolutions modifient en profondeur les conditions de travail et exigent des réponses adaptées et prospectives.
En conclusion, cette note doit être repensée pour devenir le moteur d’une politique SSCT ambitieuse, cohérente et adaptée aux réalités du ministère. Sans cela, nous risquons de perdre la maîtrise de cette politique au profit d’une vision réductrice et déconnectée de nos spécificités professionnelles. L’enjeu est également d’affirmer l’autorité du SG et de préserver l’intégrité d’une politique ministérielle forte et ambitieuse.
Merci de votre attention