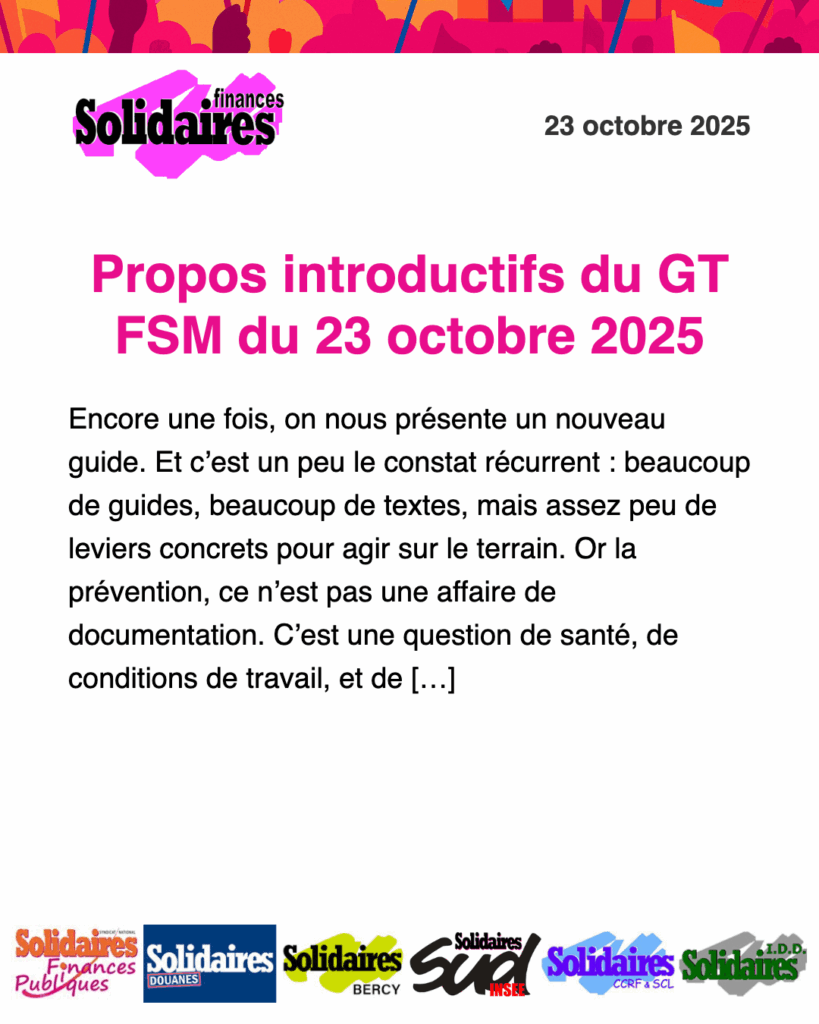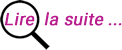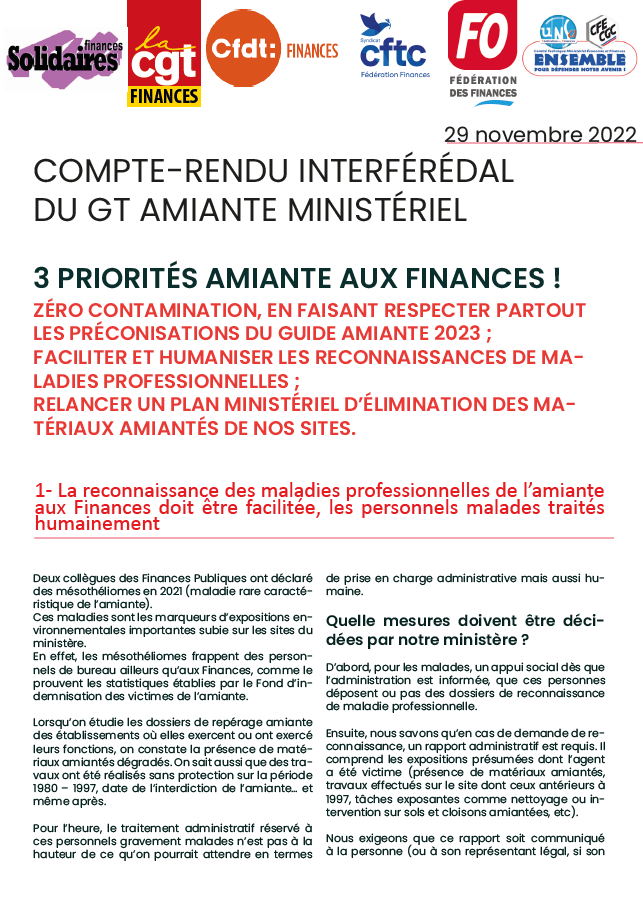Encore une fois, on nous présente un nouveau guide. Et c’est un peu le constat récurrent : beaucoup de guides, beaucoup de textes, mais assez peu de leviers concrets pour agir sur le terrain. Or la prévention, ce n’est pas une affaire de documentation. C’est une question de santé, de conditions de travail, et de responsabilité collective.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon la DARES, plus de 679 000 accidents du travail ont été enregistrés en France en 2022. Et chaque année, plus de 700 personnes meurent encore à cause de leur travail. Ce n’est pas marginal. Ce sont des vies, des familles, des équipes touchées.
Et la France reste, selon les données européennes, l’un des pays où la mortalité au travail demeure la plus élevée. Dans nos propres directions, des situations dramatiques continuent à se produire : aux Douanes, des décès reconnus comme liés au service, mais un silence persistant dès qu’il s’agit de suicides ; à l’INSEE, des alertes répétées qui peinent à trouver des réponses.
Ces faits devraient suffire à rappeler que la prévention n’est pas un sujet technique, mais une priorité de politique publique. Ce que nous attendons, c’est une véritable stratégie, claire, partagée, cohérente entre les directions — DGFiP, Douanes, INSEE — et un pilotage national qui donne du sens aux outils produits.
Sur le contenu du guide, plusieurs points méritent d’être soulignés. D’abord, la dimension collective des démarches : l’évaluation des risques, la décision de prévention ou la rédaction d’un plan d’action ne peuvent pas rester des exercices individuels. C’est dans la confrontation des points de vue que se construit une analyse utile. Ensuite, la qualité de l’évaluation des risques : trop souvent, les DUERP sont des tableaux bruts, sans hiérarchisation, sans véritable formulation des risques. Cela montre une faiblesse de méthode et un manque d’implication des services.
Il faut aussi rappeler que l’évaluation doit être genrée, car les expositions et les atteintes à la santé ne sont pas les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Enfin, il manque dans le guide ce qui devrait être central : la méthode pour construire une mesure de prévention. On parle beaucoup de principes, peu de mise en œuvre. Les services ont besoin de repères clairs, pas seulement de définitions.
Un mot aussi sur les cadres de proximité, souvent seuls à faire vivre le DUERP. Ils ont besoin de fiches simples, d’outils praticables « au fil de l’eau ». Sinon, la prévention reste théorique. Nous saluons les améliorations apportées au sommaire, la reprise des neuf principes, l’intégration d’une dimension plus collective. Mais des zones d’ombre subsistent : la place du chef de service dans l’évaluation, la transparence du recensement des actions, et surtout le manque de lisibilité du PAPRIPACT.
La prévention ne doit pas se limiter à produire des documents. Elle doit servir à transformer le travail réel, à protéger les agents, et à leur permettre de travailler sans s’abîmer. C’est dans cette logique que nous souhaitons poursuivre les échanges aujourd’hui.