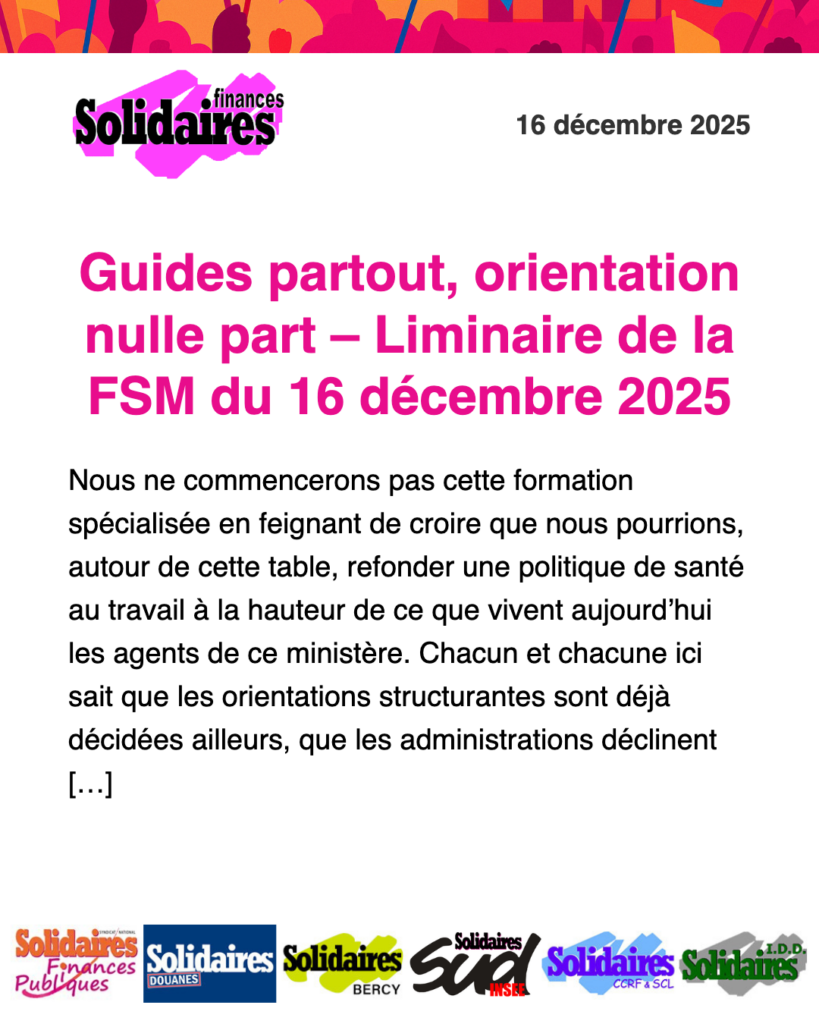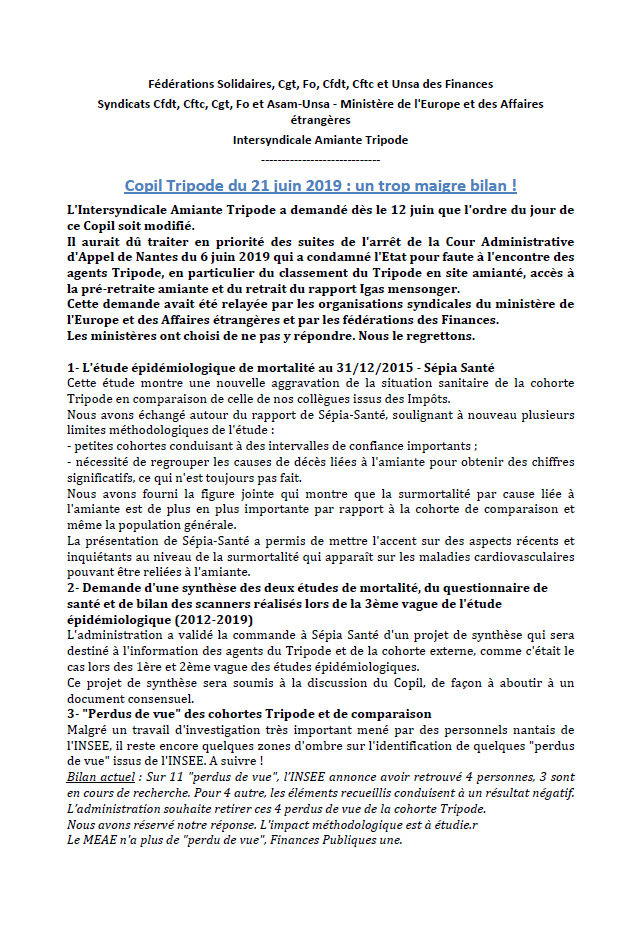Nous ne commencerons pas cette formation spécialisée en feignant de croire que nous pourrions, autour de cette table, refonder une politique de santé au travail à la hauteur de ce que vivent aujourd’hui les agents de ce ministère. Chacun et chacune ici sait que les orientations structurantes sont déjà décidées ailleurs, que les administrations déclinent des politiques gouvernementales qui privilégient l’accélération, la réduction des marges de manœuvre et la mise sous tension permanente des organisations, et que cette instance ne dispose ni des leviers budgétaires, ni du pouvoir de contrainte nécessaire pour infléchir ces choix.
Le reconnaître n’est pas un renoncement. C’est une condition pour tenir un dialogue social qui ne soit pas un théâtre. Car ce que vivent les agents n’est pas un dysfonctionnement ponctuel, mais le produit cohérent de politiques publiques qui organisent la pénurie, la désorganisation et l’intensification du travail. La dégradation des conditions de travail, la montée des atteintes à la santé mentale, les difficultés de maintien dans l’emploi, les retours en poste fragilisés, ne sont pas des effets secondaires imprévus : ce sont les conséquences prévisibles d’un système qui demande toujours plus avec toujours moins, tout en individualisant les coûts humains de cette contradiction.
Dans ce contexte, la formation spécialisée n’est pas, et ne peut pas être, le lieu où se décide une véritable politique de prévention primaire. Elle est devenue, de fait, un espace de gestion des dégâts. Cela ne la rend pas inutile, mais cela oblige à clarifier ce que nous en attendons réellement. Ce que nous refusons, en revanche, c’est qu’elle devienne un lieu de neutralisation de la réalité du travail, où l’on produirait des outils, des guides ou des restitutions qui, sous couvert d’objectivation, contribueraient à invisibiliser les causes organisationnelles de la souffrance et à disqualifier la parole collective.
Si le ministère ne peut aujourd’hui produire que des guides et des dispositifs d’accompagnement, alors notre exigence est simple : que ces outils ne fassent pas obstacle à l’action, qu’ils ne ferment pas les possibles, et qu’ils ne transforment pas la prévention en exercice bureaucratique déconnecté du travail réel. Une politique de santé au travail, même contrainte, ne peut pas se réduire à des enquêtes sans suites, à des outils chronophages centrés sur le recensement, ou à des restitutions qui concluent à l’absence de problèmes tout en renvoyant la conflictualité du travail à des « perceptions » ou à des « rumeurs ». Nous attendons a minima que les productions issues de cette instance permettent de nommer les déterminants organisationnels des atteintes à la santé, et non de les contourner. Que les rapports de médecine du travail et des inspecteurs santé sécurité au travail soient considérés pour ce qu’ils sont : des appuis essentiels à la prévention, devant être présentés, discutés et suivis, y compris lorsqu’ils dérangent.
Quand nous insistons sur le DUERP et le PAPRIPACT, il ne s’agit pas de défendre des outils pour eux-mêmes, ni de demander un énième exercice de conformité réglementaire. Une démarche DUERP digne de ce nom n’est pas un inventaire de risques abstraits ni une photographie figée des situations. C’est une analyse du travail réel, menée à partir de ce que font effectivement les agents pour tenir leurs missions, des contraintes qu’ils rencontrent, des arbitrages qu’ils opèrent au quotidien et des empêchements qui s’accumulent. Un DUERP utile commence donc par la description des situations de travail telles qu’elles sont vécues, et non telles qu’elles sont prescrites. Il identifie des risques en lien direct avec l’organisation : charges de travail irréalistes, injonctions contradictoires, instabilité des équipes, défaut de moyens, outils inadaptés, perte de sens liée à l’éloignement du cœur de métier, isolement professionnel. Il permet de faire apparaître ce qui relève de facteurs collectifs, et pas uniquement de fragilités individuelles. Sans cette étape, le DUERP se réduit à une liste générique de risques psychosociaux, interchangeable d’un service à l’autre, et donc inopérante.
Le PAPRIPACT, dans cette logique, n’est pas un tableau d’actions sans portée. Il est la traduction opérationnelle du diagnostic posé dans le DUERP. Cela signifie que chaque mesure inscrite doit répondre à une situation de travail identifiée, et non à une catégorie de risque abstraite. Une mesure de prévention n’est pas une action de communication, ni une formation décontextualisée, ni un dispositif de soutien individuel ajouté a posteriori. C’est une modification concrète des conditions d’exercice : ajustement des objectifs, redéfinition des priorités, stabilisation des organisations, renforcement des effectifs ou des compétences, clarification des rôles, évolution des circuits de décision, amélioration des outils, ou création de temps et d’espaces de régulation collective du travail.Pour qu’un PAPRIPACT ait un effet réel, il doit également être assorti d’éléments simples mais essentiels : des responsables clairement identifiés, des échéances réalistes, des indicateurs de suivi compréhensibles, et une évaluation de la mise en œuvre effective des mesures, pas seulement de leur existence formelle. Sans cela, on produit des plans qui s’accumulent d’année en année, sans que personne ne puisse dire ce qui a réellement été fait, modifié ou abandonné, ni avec quels effets sur la santé et le travail.
Nous attirons aussi l’attention sur le fait que la prévention ne peut pas être réduite à une succession d’actions locales isolées. Une démarche DUERP–PAPRIPACT cohérente suppose une articulation entre les niveaux : local, directionnel et ministériel. Elle suppose que les retours des services, les alertes des acteurs de prévention, les constats des médecins du travail et des ISST puissent nourrir des orientations plus globales, et pas seulement être traités comme des situations particulières à “gérer”. À défaut, on entretient une prévention éclatée, qui laisse les services seuls face à des problèmes structurels qu’ils ne peuvent pas résoudre.
Enfin, nous insistons sur un point souvent éludé : une démarche de prévention efficace prend du temps, des compétences et des moyens. Quand les outils sont trop complexes, quand le temps consacré au recensement écrase le temps consacré à l’action, quand les cadres de proximité ne sont pas formés à l’analyse des conditions de travail mais seulement à l’utilisation des outils, on transforme la prévention en exercice bureaucratique. Ce que nous demandons, ce n’est pas davantage de procédures, mais une prévention plus lisible, plus collective, et orientée vers des transformations concrètes, même modestes, mais réellement mises en œuvre. C’est à ces conditions, et seulement à celles-ci, que le DUERP et le PAPRIPACT peuvent devenir autre chose que des obligations réglementaires formelles. Ils peuvent alors constituer, dans un contexte contraint, l’un des rares leviers encore disponibles pour agir sur les causes organisationnelles de la dégradation de la santé au travail, plutôt que de se contenter d’en accompagner les effets.
Nous attendons également que la formation spécialisée ne soit pas dessaisie de son rôle sur les sujets qui relèvent directement de la santé au travail. Les démarches d’évaluation, les enquêtes, les dispositifs d’accompagnement doivent être discutés ici, et non pilotés à distance par des prestataires ou des conventions qui contournent l’expertise collective. À défaut de pouvoir transformer les orientations nationales, il est au moins possible de garantir que les instances ne servent pas à les habiller d’un vernis social déconnecté de la réalité vécue par les agents.
Enfin, nous posons une ligne claire : dans un contexte où les agents vont de plus en plus mal, où les collectifs sont fragilisés, où l’âge, la charge et l’instabilité organisationnelle pèsent lourdement, la priorité ne peut pas être de produire des outils supplémentaires sans se donner les moyens de leur appropriation réelle. Former l’encadrement à l’analyse des conditions de travail, reconnaître la dimension collective des risques, rendre visibles les marges de manœuvre existantes, et ne pas disqualifier la parole syndicale ou celle des agents, constituent aujourd’hui le minimum d’une politique de santé au travail qui ne renonce pas totalement à sa finalité. Nous ne demandons pas à cette instance de faire ce qu’elle ne peut pas faire. Nous demandons qu’elle ne fasse pas l’inverse de ce qu’elle prétend : produire des cadres qui empêchent d’agir, des outils qui masquent les causes, et des discours qui individualisent des problèmes profondément organisationnels. C’est à cette condition, modeste mais essentielle, que le dialogue social en matière de santé, sécurité et conditions de travail peut encore avoir un sens.
La note d’orientation ministérielle en matière de santé, sécurité et conditions de travail, désormais pluriannuelle, ne peut pas rester un simple cadre d’affichage. Une politique qui se projette dans le temps suppose un bilan explicite, des priorités claires et une mise en œuvre réelle. Or, aujourd’hui, nous ne voyons ni ce qui est effectivement porté, ni ce qui est suivi, ni ce qui est réellement transformé. La question vous est donc posée directement : quels axes choisissez-vous de faire vivre, et comment comptez-vous en assurer le pilotage ? Cette situation est indissociable d’un affaiblissement plus général du contrôle et de la contrainte. À force de cantonner la prévention à l’incitation et au conseil, l’administration accepte de fait que le respect de la réglementation devienne variable selon les directions. Sans capacité de contrôle réel, sans leviers coercitifs, la prévention repose sur la bonne volonté, et l’on en mesure aujourd’hui clairement les limites.